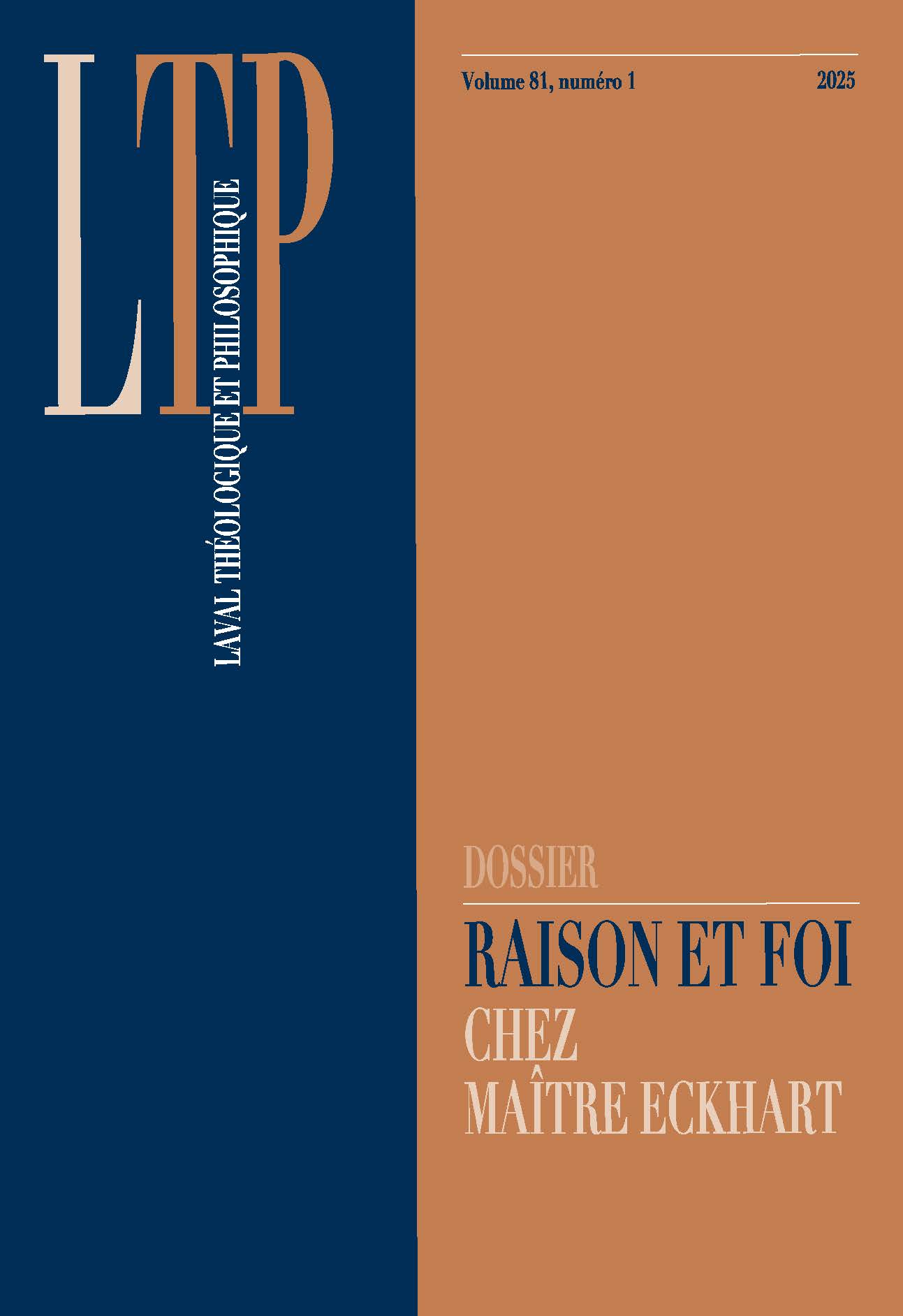Liminaire
Résumé
Dans son ouvrage Raison et foi (2003), Alain de Libera fait valoir une alternative au schéma d’Etienne Gilson auquel souscrit Jean-Paul II dans l'encyclique Fides et ratio : une montée progressive vers la pensée de Thomas d’Aquin suivie d’une période de décadence. Cette vision de la scolastique, trop monolithique, ne tient pas compte de l’originalité de l’école colonnaise. Au milieu du XIIIe s, Albert le Grand décide d’intégrer la philosophie péripatéticienne gréco-arabe comme voie d’accès à la béatitude annoncée par le christianisme. Maître Eckhart hérite de cette innovation et en fait l’épine dorsale de son articulation entre philosophie et théologie. Il l’annonce dans un écrit latin programmatique : le sermon pour la Saint Augustin. Ce n’est pas la métaphysique mais l’éthique qui devient chez lui la voie royale de la théologie : ethica sive theologia. Or, si l’éthique est identifiée à la théologie en tant que recherche spéculative, elle est aussi confirmée par l’approche pratique : ethica sive practica. De la sorte, l’action et la contemplation sont réunies. C’est dans l’exercice même des vertus que l’objectif de philosophie intellectuelle est accompli. Dieu n’y est pas l’objet d’une vision théorétique, mais la raison première de toutes choses. C’est ainsi que Maître Eckhart ose traduire le premier verset du prologue johannique : « In principio erat logos, ratio scilicet » (In Ioh. §32). Dieu est éprouvé comme le fond d’où émanent toutes choses mais également tous les actes humains, l’intellection y compris. Un seul mot moyen-haut-allemand réunit les deux termes latins Ratio et Causa : grunt (Grund). Cela veut dire qu’en tant que productrice et opérative, la raison est désorbitée du champ uniquement notionnel. Elle concerne autant l’intellect que la volonté. En optant pour cette voie, Eckhart déjoue l’opposition entre raison et foi, comme deux voies de connaissances parallèles, l’une naturelle et l’autre surnaturelle. Mais la question se pose alors : s’agit-il d’une stratégie d’évitement ou bien Eckhart a-t-il proposé une autre façon pour entendre ce que la foi veut dire ? Ce problème mériterait que l’on s’y attèle. La méthode proposée est d’exhumer les textes où Eckhart parle de la foi, ou mieux encore de la foi et de la raison, pour tenter de déceler son apport spécifique sur ce thème délicat. Finalement, le but de l’exercice est heuristique, autant qu’herméneutique. Il consiste à découvrir si l’interprétation eckhartienne est révolue, datée historiquement, ou si elle est encore opératoire, car relevant de la vie elle-même. Dans ce dernier cas, ne pourrait-elle pas faire entrer un peu d’air frais au milieu d’une impasse conceptuelle peu propice à la réception du christianisme dans l’époque actuelle ?